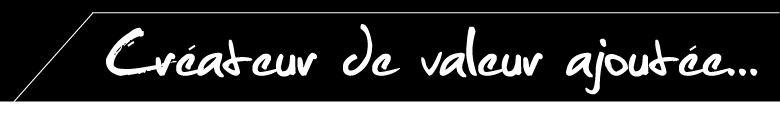OCTOBRE 2015
Installation du progiciel TRACEFRUIT dans les 10 stations du groupe KANTARI à BERKANE...
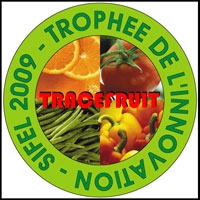
ACTUALITES

LA REGLEMENTATION AGRO-ALIMENTAIRE
La priorité depuis 2005, pour les acteurs de l’industrie agro-alimentaire, c’est bien sûr la mise en application du règlement 178/2002. Il confère aux professionnels du secteur un certain nombre d’obligations.
Quelles sont les contraintes apportées par cette directive ? Quelles sont les perspectives dans les entreprises françaises ? Quelles sont les garanties engendrées pour le consommateur ?
Il convient tout d’abord de rappeler que le règlement 178/2002 n’est pas le premier texte européen en matière de sécurité alimentaire. En effet, la directive 2001/95CE relative à la sécurité générale des produits entrée en application en janvier 2004 engage la responsabilité du metteur en marché et impose un signalement en cas de problème. Cette directive s’applique lorsqu’il n’y a pas de dispositions spécifiques régissant la sécurité des produits concernés parmi les réglementations communautaires et lorsque ces législations sectorielles présentent des lacunes. Le règlement 178/2002 spécifique aux denrées alimentaires comble ces lacunes et impose quant à lui la traçabilité.
Depuis avril 2004, le règlement 1830/2003 précise l’étiquetage et la traçabilité des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’OGM. Ainsi, les entreprises doivent mentionner la présence d’additifs ou d’arômes contenant ou consistant en des OGM sur les étiquettes des denrées et ingrédients alimentaires.
La directive 2003/89CE est liée à l’information des consommateurs. Son entrée en application le 25 novembre prochain rendra obligatoire l’affichage de tous les ingrédients allergènes. Cela répond à la demande d’informations des consommateurs qui doivent avoir accès à tous les renseignements dont ils ont besoin sur l’emballage des produits. En effet, « il ne suffit pas que les denrées alimentaires soient sûres : les consommateurs ont le droit de savoir ce qu’ils achètent et si cela correspond à leurs besoins. Les règles européennes en matière d’étiquetage des denrées alimentaires existent depuis de nombreuses années, mais elles sont constamment mises à jour. En conséquence, les consommateurs pourront dans le futur identifier plus facilement les ingrédients auxquels ils peuvent être allergiques. L’élaboration de définitions claires et identiques dans toute l’Union, d’allégations telles que "faible teneur en matières grasses" et "riche en fibres" est à l’étude. »
Enfin, depuis octobre 2006 est applicable le règlement 1935/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Règlement qui en prévoit la traçabilité.
Le règlement 178/2002
« Les principes généraux de sécurité des denrées alimentaires sont énoncés dans un règlement adopté en 2002 et souvent qualifié de législation alimentaire générale. Ce règlement « cadre » résulte d’une révision approfondie de la législation européenne en matière de sécurité alimentaire, laquelle accorde désormais une attention particulière aux aliments pour animaux. C’est grâce à ce règlement que les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale sont tenues, depuis le 1er janvier 2005, d’assurer la traçabilité de toutes les denrées alimentaires, de tous les aliments pour animaux et de leurs ingrédients tout au long de la chaîne alimentaire. » Ce règlement est complété par cinq règlements formant le « paquet hygiène » dont trois applicables aux professionnels de l’agroalimentaire.
L’article 18 du règlement 178/2002 définit le terme de traçabilité comme étant la « capacité à retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une denrée alimentaire, d’un aliment pour animaux, d’un animal producteur de denrées alimentaires ou d’une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux. »
Afin de répondre à ces obligations, des mesures doivent être mises en place. Ainsi, les industriels et distributeurs du secteur doivent :
* Assurer un archivage des flux pendant 5 ans ;
* Savoir restituer l’information grâce à la mise en place d’un système structuré ;
* Assurer la traçabilité immédiate de l’étape précédente et suivante, la traçabilité totale étant reconstituée par les Autorités.
D’autre part, il est à noter que le règlement s’applique :
à tous les produits (Origines indifférentes) ;
à tous les acteurs de l’UE (25 pays).
Les exigences accrues du nouveau règlement en matière d’assurance sur l’origine des produits (et des ingrédients qui les composent) et les attentes de plus en en plus précises des consommateurs nécessitent une amélioration et une extension des systèmes de traçabilité.
2-) HISTORIQUE
DEFINITION DETAILLEE
Toute action se définit forcément par un sujet, un verbe et un objet sur lequel porte l’action. La traçabilité porte forcément sur des objets. Or la nature de ces objets n’est jamais homogène pour être définie de façon unique. De plus, un prestataire de transport cherchera à connaître des détails sur l’expédition d’un colis, alors que son client ne s’intéressera qu’à un lieu à un instant donné. Ces précisions font partie intégrante de la définition d’un projet de traçabilité.
1. Les objets tracés
Dans tout process, on trace une entité physique, qu’on pourra définir comme un objet physique, et utiliser en tant que terme générique. Plus exactement, on peut tracer une unité de consommation comme un groupe de palettes, qu’on considérera alors comme une entité dans sa globalité. On identifie le type d’objet, ou le contenant associé au produit. Pour un même produit fini, on aura également plusieurs types de contenants, ou d’emballages :
- L’unité de consommation elle-même ;
- Les sachets, comme par exemple pour du co-packing ou des lots promotionnels;
- Les cartons, de tailles différentes selon les destinataires, la nature du produit, le type de manipulations à effectuer...
- Des couches de palettes, dans le cas de palettes non homogènes, ou qui contiennent au moins deux produits différents ;
- Des palettes, dès que les quantités l’imposent, et pour des raisons de facilités de manipulation.
Il est important de souligner que chaque entité est identifiée de façon unique, quelle qu’elle soit. Sur ces objets, on cherche à conserver certaines caractéristiques ou informations.
2. Les informations
Chacun de ces objets doit être identifié et codifié dans un système de gestion. Prenons l’exemple d’un site logistique. Cela signifie que dans l’entrepôt virtuel, chaque objet de traçabilité doit être représenté par un code à partir duquel on peut connaître immédiatement les informations nécessaires à sa gestion, comme par exemple :
- La référence du produit, donc la nature de la marchandise, la combinaison Référence/Couleur/Taille dans le cas d’un produit décliné en plusieurs " versions ", par exemple dans l’industrie textile. C’est une des caractéristiques tracées.
- Les dates de fabrication, de limite de vente, de fin de commercialisation...
- La date d’entrée en stock, qui peut être considérée comme une date FIFO ;
- Les niveaux de stocks minimum, maximum... en quantités etc.
Il faut distinguer deux types d’informations : les informations qu’on pourrait définir comme "statiques" des informations de type "historique". Une information statique correspondrait par exemple à l’état d’un colis, ou l’emplacement d’une palette à un instant donné. Au contraire, les historiques n’ont pas de limite de temps. Les progiciels de gestion d’entrepôt peuvent attribuer de façon automatique un numéro unique à tout objet qui entre sur le site. D’une façon générale, il est possible, par une requête, de connaître le trajet d’un objet (au sens du système) à partir de son entrée jusqu’à sa sortie.
Tout ceci pourrait correspond à une recherche directe d’informations. Une recherche indirecte oblige l’utilisateur, toujours à partir d’un numéro d’objet, à passer par une base de données pour rechercher d’autres informations. Par exemple, on retrouve une palette qui avait été physiquement "perdue" dans un entrepôt, et grâce à son numéro identifiant, on peut savoir par quel transporteur elle est arrivée.
Les informations tracées sont toujours très nombreuses pour être traitées manuellement, que ce soit pour être écrites à la main sur une étiquette apposée sur l’emballage, ou saisies dans le système de gestion. C’est pourquoi on les codifie grâce entre autres aux différents types de codes reconnus par les normes EAN-GENCOD.
1-) DEFINITION
DEFINITION
La traçabilité est définie comme l’aptitude à retrouver l’historique, l’utilisation ou la localisation d’un article ou d’une activité, ou d’articles ou d’activités semblables, au moyen d’une identification enregistrée (ISO 8402). Elle permet de suivre et donc de retrouver un produit ou un service depuis sa création (production) jusqu’à sa destruction (consommation).
HISTORIQUE
Née dans le milieu des années 80, la traçabilité répondait alors à un simple souci logistique : elle garantissait un contrôle des flux de marchandises au sein d’une chaîne de partenaires, permettant de sérieuses économies. Mais ce n’est pas pour cette raison que plusieurs sociétés françaises et étrangères, alors que rien ne les y contraignait, ont récemment pris le parti de se doter de systèmes complets de traçabilité.
A l’heure de la mondialisation économique et de la complexification des échanges, la responsabilité des chefs d’entreprise, engagée en cas de crise, ne repose plus uniquement sur une entité unique.
La récente affaire Coca-Cola® l’a d’ailleurs bien prouvé : alors que la firme d’Atlanta et ses filiales européennes disposaient d’un système de traçabilité, elles se sont vues interdire la vente de leurs produits par les gouvernements belge et français parce que leurs clients grossistes ne pouvaient tracer leurs échanges commerciaux.
La traçabilité, déclinée sous de multiples formes, va devenir dans les années qui viennent, un outil incontournable pour toutes les entreprises.
Aujourd’hui, elle concerne tous les secteurs d’activités et non plus certains secteurs exposés (agroalimentaire, pharmacie, aéronautique...). Elle s’avère indispensable pour des raisons autres que purement logistiques : relation de confiance envers le consommateur, contraintes réglementaires et légales, normalisation, rappel de produits défectueux, commerce électronique...
PROGICIELS